
LE JOURNAL
N°113
-
- 1-Ordures
ménagères:questions de coûts.
- 2-La
présidence française de l'Union européenne.
- 3-L'hygiène
sur les marchés.
-
- 1-Ordures
ménagères
- Comment
sont financés la collecte et le traitement des ordures ménagères?
- Les
coûts d'exploitation du service de collecte et de traitement des ordures
ménagères sont essentiellement financés par la taxe d'enlèvement
des ordures ménagères. L'application de cette taxe est définie
par le Code général des impôts. Cette taxe est donc un
impôt qui est perçu au titre de la taxe foncière.
- Qui
paye cette taxe ?
- Tous
les propriétaires, qu'ils soient particuliers ou professionnels payent
la taxe foncière et donc la taxe d'enlèvement des ordures ménagères
(les propriétaires peuvent répercuter cette taxe sur leurs locataires).
Dans la mesure où cette taxe est un impôt, elle est obligatoire
que l'on utilise ou nhon ce service.
- Les
professionnels contribuent à payer 1/3 du produit total de la taxe.
- Pourquoi
cette taxe est-elle obligatoire pour tout le monde ?
- A
la différence de la collecte et du traitement des eaux qui sont mesurables
grâce aux compteurs d'eau, il n'existe pas de système fiable
pour mesurer la quantité de déchets rejettée par chacun
d'entre nous. Aussi, on considère que toutes les activités domestiques
ou professionnelles génèrent, directement ou indirectement,
une quantité moyenne de déchets qu'il faut collecter et traiter.
- Cet
impôt concerne donc tout le monde.
- Qui
ne paye pas la taxe ?
- Seuls
les usines, les établisemments publics et scolaires sont exonérés
de la taxe.
- Qui
perçoit la taxe ?
- Ce
sont les services de l'administration fiscale qui perçoivent les revenus
de la taxe foncière. La plus grande partie de ces revenus est reversée
à la CUDL et participe à la couverture des dépenses de
fonctionnement du service de collecte et de traitement des ordures ménagères.
8 % de ces sommes sont conservées par l'administration fiscale pour
couvrir les frais de gestion.
- La
taxe couvre-t-elle tous les frais de fonctionnement du service ?
- En
1995, les revenus de la taxe couvraient près de 75% du coût total
du service. Le reste est financé par le budget général
dela CUDL.
- Aujourd'hui,
les revenus couvrent près de 80% du coût total du service.
- Quels
sont les facteurs d'augmentation du coût du service ?
- L'augmentation
prévisionnelle est essentiellement dûe aux nouvelles réglementations
relatives à la protection de l'environnement. Ainsi, les pneus, batteries
par exemple ne sont plus acceptés en décharge et doivent être
traités séparément. il faut noter que la collecte sélective
n'intervient que pour une part très faible dans les futures augmentations.
- 2-La
présidence française de l'Union européenne.
- La
France présidera l'Union européenne au second semestre 2000.
Ce sera l'occasion de faire partager et avancer ses conceptions sur des points
auxquelles elle tient particulièrement.
- La
sécurité alimentaire
- il
s'agit de mettre en oeuvre le Livre blanc sur la sécurité alimentaire,
adopté par la Commission le 12 janvier 2000, et qui prévoit
la création d'une Autorité alimentaire européenne indépendante
et de nombreuses propositions législatives.
- La
Frane bénéficie à cet égard de l'expérience
récente de la mise en place de l'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments (AFSSA).
- L'objectif
est de fixer les grandes lignes de fonctionnement de cette Autorité,
de façon suffisamment opérationnelle pour faire aboutir rapidement
le processus juridique de création.
- Sur
les propositions législatives, elle annonce parmi ses priorités
: les OGM, les compléments alimentaires et l'harmonisation des contrôles.
- Sur
les OGM, la présidence française se fixe pour objectifs de combler
les lacunes et d'améliorer la cohérence d'étiquetage.
Elle mettra en chantier l'élaboration d'un cadre juridique visant à
assurer une traçabilité totale pour les filières agro-alimentaires.
- La
France appuiera la proposition de la Commission de créer un nouveau
cadre communautaire pour les systèmes de contrôle nationaux visant
l'alimentation humaine et animale dans la totalité de la chaine alimentaire.
Mais elle veillera à ce que chaque Etat reste maître de la gestion
et de l'organisation de son propre système, en application du principe
de subsidiarité.
- 3-L'hygiène
sur les marchés : des inquiètudes non fondées.
- L'arrêté
du 9 mai 1995 relatif à l'hygiène des aliments remis directement
aux consommateurs a transposé aux marchés les dispositions de
la directive 93/43 sur l'hygiène des aliments.
- Ce
texte soumet les marchés de plein air à des dispositions similaires
à celles des autres circuits de distribution. En effet, chaque amillon
des filières alimentaires, quelles que soient ses spécificités,
doit maîtriser l'hygiène des produits mis en vente, éviter
les risques de contamination et de développement des micro-organismes.
- Ceci
implique une mise à niveau des équipements des commerçants,
notamment en matériel de conservation des denrées à des
températures réfrigérées.
- L'arrêté
souligne surtout les objectifs de sécurité à atteindre,
comme la température de conservation ou la propreté corporelle,
afin d'éviter le développement des micor-organismes dangereux.
Le choix des moyens est généralement laissé aux professionnels,
qui peuvent s'aider des guides de bonnes pratiques d'hygiène élaborés
par leurs organisations. ils disposent donc d'un large éventail de
moyens adaptés à l'environnement des marchés et type
de denrées.
- Le
secrétariat d'Etat aux PME, au commerce, à l'artisanat et à
la consommation accompagne cette transition depuis plusieurs années.
il surveille la modernisation de l'équipement des marchés (électricité,
points d'eau, sanitaires), rappelle aux maires des communes concernées
les échéances et les aides financières existantes.
- La
diversité des solutions envisageables doit donc permettre à
tous les professionnels d'atteindre les objectifs de sécurité
sans remettre en cause l'existence des marchés, éléments
essentiels de la vie et de l'animation des communes françaises.
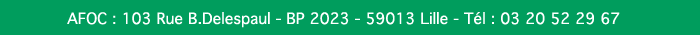
- Retour
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
